Là réside la force de la VR : en une minute, on peut totalement se déconnecter de la réalité, être projeté dans une autre dimension. Le 360 a cette qualité incroyable de mettre la personne à l’écoute. Et une fois attentive, il s’agit de lui délivrer le bon message : c’est notre métier.
GRÉGOIRE MOISSON
Fondée en 2017, Wild Immersion est une entreprise pionnière dans la production d’expériences immersives centrées sur la nature et la faune sauvage. Spécialisée dans la réalité virtuelle et la captation VR 360° mais proposant également des formats alternatifs (projections / expériences en réalité augmentée) et modules d’exposition, elle crée des contenus ludo-éducatifs – alliant rigueur scientifique, émerveillement et narration – conçus pour reconnecter le public avec la biodiversité, que ce soit en salle de classe, dans les musées, les zoos ou les structures de santé.
Grégoire Moisson, cofondateur et dirigeant de Wild Immersion, nous partage une vision et une stratégie où se mêlent technologie, edutainment et engagement écologique. Sous sa direction, Wild Immersion continue d’étendre son rayonnement international et d’innover dans des projets qui capturent non seulement des espèces et paysages emblématiques, mais mettent aussi en lumière les enjeux environnementaux, inspirent l’action et favorisent le bien-être mental
Pouvez-vous présenter Wild Immersion et votre rôle au sein de cette structure
Grégoire Moisson : Wild Immersion est une société spécialisée dans la création d’expériences immersives autour de la nature et de la vie sauvage. Notre objectif est triple : émerveiller le public, transmettre des connaissances et, lorsque c’est possible, engager l’action des visiteurs. Pour ma part, je suis cofondateur de l’entreprise et j’en assure aujourd’hui la direction.
Formats et diffusion
Les expériences Wild Immersion se déclinent en une diversité de formats et de lieux de diffusion. Pouvez-vous nous donner trois exemples de ces différents formats et contextes ?
G. M. – Nous avons plusieurs grands marchés. Le premier, ce sont les zoos, les aquariums et les musées. Parmi la trentaine de lieux auprès desquels nous intervenons, l’Université autonome de Mexico (UNAM) est un exemple original. Nous y présentons nos contenus dans “Universare”, un espace conjoint au musée de 150 m². Les visiteurs commencent par un film introductif sur la place de l’homme dans la nature, puis découvrent un film VR narratif de quinze minutes sur un biome particulier. L’expérience se poursuit avec une mini-exposition illustrée par une fresque murale, puis une activité interactive où les visiteurs dessinent et colorient des animaux qu’ils peuvent ensuite scanner pour les voir prendre vie. Pour prolonger l’expérience, nous proposons même une chasse au trésor en réalité augmentée autour du bâtiment. C’est un exemple de la transversalité de l’offre que nous cherchons à proposer, avec la réalité virtuelle comme joyau central, mais accompagnée d’autres expériences immersives adaptées à tous les publics.

Le deuxième marché, c’est l’éducation. Depuis un an, nous intervenons dans les salles de classe au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Costa Rica ou en Australie, avec des formats très variés : certaines séquences durent 30 à 45 secondes pour capter rapidement l’attention des élèves, tandis que d’autres durent 12 à 15 minutes et sont suivies de discussions et d’activités pédagogiques. Récemment, notre partenaire au Costa Rica a recréé des films spécifiquement adaptés aux programmes académiques des États-Unis, du Costa Rica et du Honduras.
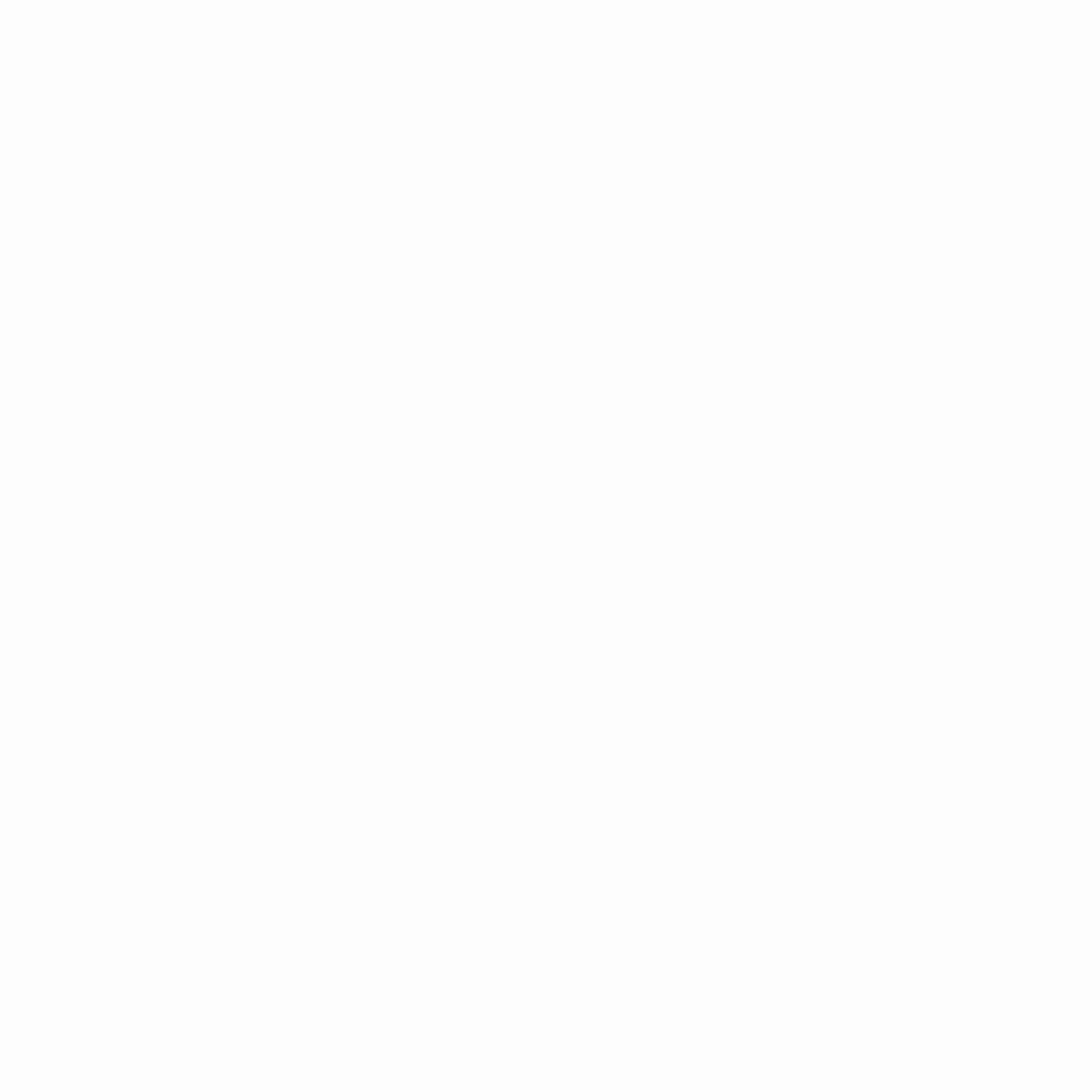
Enfin, le troisième usage de nos contenus concerne la santé mentale au sens large du terme. Nous permettons par exemple à des personnes âgées en maisons de retraite de revivre safaris, plongées ou balades à travers le monde, grâce à la VR. Nous collaborons également avec Floreo VR, une société américaine qui aide des enfants autistes à appréhender leur environnement en toute sérénité grâce à nos animaux virtuels. Enfin, nous travaillons avec des hôpitaux et notamment Sunrise association, aux États-Unis, qui accompagne des enfants atteints de cancer et leur offre à travers les modules de films Wild Immersion une évasion bienvenue pendant de longues séances de traitement.
Futurs projets d’exploration du monde animal
Vous avez déjà filmé dans de nombreux territoires terrestres et marins, de l’Amazonie à la savane africaine. Quels sont vos prochains projets ? Reste-t-il encore des territoires inexplorés ou des espèces emblématiques que vous souhaitez filmer ?
G. M. – Nous avons plusieurs projets à venir. Premièrement, nous souhaitons explorer davantage les phénomènes naturels, pas uniquement les animaux, en nous intéressant par exemple au ciel et à l’espace. Nous venons ainsi de réaliser un film sur l’éclipse solaire totale de 2024, combinant images réelles et animation pour montrer l’influence des astres sur notre planète. Nous travaillons également avec ce que nous appelons les « Witness of the Earth » : des témoins de la planète qui ont consacré leur vie à la protection de la nature, comme le Dr Jane Goodall, partie le 1er octobre 2025, et son immense héritage sur les chimpanzés, ou la navigatrice Alexia Barrier et sa préparation du trophée Jules Vernes avec un équipage 100% féminin. Un autre projet consiste en un tour du monde en slow motion effectué par deux de nos réalisateurs, sur une année, pour capturer la diversité de la nature au quotidien.
Quant à votre question sur les espèces emblématiques, nous en avons filmé une grande partie, mais certaines nous manquent encore, comme les tigres ou les éléphants d’Asie. Cependant, ce qui nous intéresse surtout, c’est de montrer différents niveaux de faune : les oiseaux, les poissons plus petits, les mammifères discrets, et même les rongeurs. Nous avons déjà commencé par un film sur les insectes et souhaitons poursuivre dans cette voie, afin de dépasser la vision touristique et spectaculaire des animaux.
En résumé, nous voulons explorer les paysages, les phénomènes naturels, et mettre en lumière ceux qui consacrent leur vie à la nature, tout en abordant des strates variées de la faune, jusqu’aux plus petites espèces.
Anecdotes de tournage et coulisse de production
Un tournage avec des animaux sauvages comporte certainement des imprévus. Auriez-vous une anecdote marquante ou insolite à partager, qui illustre les coulisses de vos productions ?
G. M. – Oui et elles sont nombreuses. Au début, mon frère et un de ses amis sont partis tourner en Afrique avec un équipement qu’ils maîtrisaient à peine. Ils avaient investi dans des caméras Titan, de grosses boules impressionnantes, mais dès le premier jour face aux éléphants, une caméra est littéralement détruite. Le lendemain, le premier lion qu’ils croisent pulvérise la seconde caméra. Au bout de deux jours, il ne leur restait plus rien. C’est à ce moment qu’ils ont décidé de passer à des caméras plus petites, moins visibles pour les animaux, acceptant de perdre un peu en qualité d’image mais de gagner en fiabilité et en quantité de prises. Depuis, nous avons accumulé des images uniques, comme celles de pandas dans la nature – une prouesse rare pour la 360°, car cette espèce est extrêmement surveillée. À Gombe, où la docteure Jane Goodall a travaillé, nous avons pu capter des comportements fascinants des chimpanzés : leur vie sociale, l’usage de plantes pour se soigner, et leur capacité à utiliser des outils pour se nourrir, comme des aiguilles d’arbre pour attraper des fourmis.
Mais il y a aussi les anecdotes liées aux spectateurs et aux visionnages des films. Une médiatrice nous a raconté qu’un enfant autiste, après avoir mis le casque, a soudain prononcé “iguana”, alors qu’il n’avait pas parlé depuis plusieurs mois. Dans le même ton, un jeune patient en chimiothérapie a enfilé le casque et a crié de joie ; il l’a gardé pendant une heure et demie, fasciné par l’expérience. Ces moments montrent combien la nature immersive peut avoir un impact émotionnel profond, bien au-delà de l’émerveillement.
Des productions entre divertissement, éducation et sensibilisation
Avec son credo « créer l’émotion, inspirer le futur, expérimenter la nature », Wild Immersion se situe à la croisée du divertissement, de l’éducation et de la sensibilisation aux enjeux environnementaux. Comment articulez-vous ces trois dimensions – émerveillement, prise de conscience et transmission scientifique – notamment dans le choix de vos thématiques et de vos partenaires (financiers, scientifiques, institutionnels) ?
G. M. – Au départ, nous proposions uniquement de l’émerveillement, avec des films contemplatifs qui laissaient les spectateurs s’exclamer “Wahou”. Mais nous avons rapidement compris que l’expérience devait se structurer en trois étapes.
La première est une mise en contexte. C’est là que les médiateurs interviennent : un “film de preshow” introduit les visiteurs, leur explique qu’ils sont là pour rencontrer la nature comme jamais auparavant, et les prépare à plonger dans l’expérience immersive.
Ensuite vient le film principal. Ici, la science prend le relais. Alors qu’hier nous étions dans le contemplatif, aujourd’hui nous sommes plutôt dans le narratif. L’émerveillement reste central – un lion qui apparaît à quelques centimètres, un vol avec des drones – mais environ 40 à 50 % du temps, une voix raconte une histoire, mêlant images brutes et motion design, et intégrant des faits scientifiques. Elle peut traiter de phénomènes naturels comme la grande migration en Afrique, l’adaptation des mammifères au réchauffement climatique ou le repeuplement de l’Europe par les grands mammifères.
Enfin, la troisième étape consiste à inciter à l’action. Après avoir émerveillé et informé, nous montrons qu’il est possible d’agir. Chaque spectateur peut contribuer à son niveau : les citadins peuvent soutenir des associations sur le terrain par des dons, d’autres peuvent réaliser de petites actions concrètes, et les plus engagés peuvent rejoindre des ONG pour replanter des coraux, par exemple. Ainsi, l’expérience se déploie en trois temps : mettre en contexte, émerveiller et éduquer, puis inciter à agir.
L’émotion comme levier d’une prise de conscience
Les expériences immersives, et en particulier la réalité virtuelle, sont de puissants vecteurs d’émerveillement et d’émotions. Considérez-vous cette dimension sensible comme un levier essentiel d’une prise de conscience de la crise de la biodiversité qui encouragerait des comportements responsables face aux enjeux environnementaux ?
G. M. – Nous avons un paradoxe dans la VR. Je pense que Lucid Realities comme Wild Immersion aurait aimé que chaque foyer ait un casque, que la réalité virtuelle soit accessible partout. Ce n’est pas le cas, et cela limite la diffusion de nos contenus à domicile. Mais la bonne nouvelle, c’est que le 360 reste ainsi unique et rare : les gens ne peuvent le découvrir que dans un musée, un zoo ou un lieu spécialisé. Et là réside sa force : en une minute, on peut totalement se déconnecter de la réalité, être projeté dans une autre dimension.
Le 360 a cette qualité incroyable de mettre la personne à l’écoute. Et une fois attentive, il s’agit de lui délivrer le bon message : c’est notre métier. Que ce soit pour émerveiller dans un centre ou un zoo, pour relaxer des personnes âgées, ou pour faire oublier la maladie à un enfant, le principe reste le même : on transporte le spectateur, loin de l’instant présent et de son quotidien, pour le plonger dans des habitats préservés au plus près d’animaux sauvages
Une alternative aux zoos ?
Vos films immersifs offrent une rencontre directe avec le monde animal, dans son habitat naturel, sans les contraintes ni les controverses liées à la captivité. À ce titre, pensez-vous que la réalité virtuelle puisse constituer une alternative crédible et éthique aux zoos traditionnels ? Quel rôle peut-elle jouer dans la réflexion plus large sur le bien-être animal ?
G. M. – La réponse est assez claire pour ma part. La discussion sur les zoos nous a souvent opposés mon frère et moi : il était plus activiste, moi plus entrepreneur pragmatique. Mais l’évolution des pratiques rend aujourd’hui la captivité moins problématique qu’autrefois. Les animaux en captivité sont nés sur place, et certains participent même à des programmes de repeuplement pour les espèces menacées. Les prélèvements dans la nature appartiennent au passé pour l’immense majorité des zoos qui suivent les règles et pratiques des associations zoologiques mondiale et européenne (WAZA, EAZA).
Il faut donc différencier deux types de zoos. D’un côté, ceux qui jouent le jeu et se préoccupent véritablement du bien-être animal : enclos plus grands, visites mieux encadrées, réduction des nuisances sonores. Dans ces établissements, les équipes sont composées de passionnés, vétérinaires et amoureux de la nature, qui n’accepteraient pas de travailler autrement. De l’autre côté, il y a d’abord des institutions qui stagnent, souvent publiques, contraintes par l’espace et manquant de vision politique. Ces zoos n’évoluent pas et, sans citer de noms, ce sont eux que nous sommes prêts à remplacer ou accompagner seulement si un vrai changement survient. Il y ensuite des zoos commerciaux ou des parcs à thème animaliers, où l’animal est trop souvent instrumentalisé pour le divertissement. La manipulation excessive, même encadrée, ne nous convient pas : nous avons rompu un contrat avec un établissement américain lorsque nous avons découvert les pratiques exactes sur place.
Enfin, il ne faut pas négliger que certains parcs font un vrai travail de conservation. J’ai discuté avec Jane Goodall, qui a passé trente ans dans la forêt avec les chimpanzés. Sa réflexion est simple mais frappante : pour un gorille, vaut-il mieux vivre traqué par des braconniers dans la nature et subir la perte de sa famille, ou dans un parc où il bénéficie de soins, d’espace et de sécurité ? Aujourd’hui, de nombreux parcs offrent aux animaux des conditions proches de la naturalité : les grilles sont invisibles, le territoire respecté, et l’animal n’est pas perturbé. Ceci rejoint un principe écologique fondamental : certaines espèces, comme les lions ou les tigres, ne peuvent dépasser la densité que leur territoire autorisé. Leur espace vital définit leur nombre, et dès lors qu’il est suffisant, l’animal se comporte naturellement. Idéalement, 30 % de la planète devrait être réensauvagée pour garantir un vrai monde sauvage. En attendant, les zoos responsables jouent un rôle crucial dans la conservation des espèces. La plupart des initiatives de sauvegarde sont d’ailleurs financées par ces institutions elles-mêmes – un chiffre méconnu, mais qui pourrait représenter entre 75 et 90 % du financement global. Mais ces efforts dits in situ, dans les zoos, ne prennent leur sens qu’avec des actions ex situ dans la nature. Nous sommes ainsi attentifs aux programmes de conservation de nos partenaires. En faire la promotion est aussi au cœur de notre métier.
Vers une reconnaissance institutionnelle ?
Existe-t-il aujourd’hui un label ou une certification capable d’encadrer ou de valoriser des initiatives comme la vôtre, à la croisée de l’innovation technologique, de la médiation culturelle et de la protection animale ? Si ce n’est pas encore le cas, envisagez-vous de travailler dans cette direction pour renforcer la légitimité et la visibilité de vos engagements ?
G. M. – Il n’existe pas de label officiel car je pense que nous sommes à la croisée de trop de chemins. Cependant, nous travaillons de plus en plus avec des zoos et aquariums pour les accompagner dans la digitalisation de leurs activités, en partenariat avec des associations spécialisées comme l’European Association of Zoos and Aquariums. L’objectif est de les aider à transformer progressivement leur manière de présenter la vie sauvage.
Dans ce cadre, Wild Immersion s’est renforcé dans ses expertises scénographiques et techniques pour proposer des expériences immersives encore plus complètes. L’idée est de tirer parti de toutes les technologies disponibles pour recréer une interaction entre l’homme et la nature, en respectant l’éthique animale et en limitant la captivité.
Ces initiatives commencent à susciter un intérêt croissant parmi nos partenaires, et pour l’instant, nous ne comptons pas trop sur les institutions publiques, mais nous y viendrons peut-être.


