Pour que des technologies encore marginales comme la VR trouvent leur place, elles ont besoin de créateurs qui remettent l’humain au centre de l’équation. La question n’est pas : “Qu’est-ce que la technologie peut faire ?” mais plutôt : “Qu’avons-nous à raconter de notre humanité grâce à elle ?”. La technologie doit rester un outil et non une finalité.
Dominic Desjardins
La Maison de Poupée est un monde en papier qui se déplie, dans lequel Juniper, 9 ans, démêle des sentiments de culpabilité liés à la façon dont sa famille a traité Magnolia, une femme venue de loin pour travailler dans leur maison. Ce conte en réalité virtuelle animée et interactif explore la manière dont les dynamiques de pouvoir naissent dans l’intimité de nos maisons. En rejouant des souvenirs avec ses poupées, Juniper a honte de ses actes et trouve le courage de ne pas être d’accord avec ses parents et de suivre son cœur. L’aiderez-vous à demander pardon?
Réalisateur, producteur et cofondateur de la société de production canadienne Zazie Films avec Rayne Zukerman, Dominic Desjardins développe depuis plusieurs années des projets qui placent l’humain au cœur d’une réflexion esthétique et sociale. Issu du documentaire et engagé sur les enjeux de droits humains, il s’attache à explorer ce que la technologie peut révéler de notre relation à l’autre. Avec La Maison de poupée (The Dollhouse), il poursuit cette démarche en collaboration avec Charlotte Bruneau, en mobilisant les spécificités de la VR pour faire émerger une prise de conscience intime, sensible et durable.

Le choix du sujet
The Dollhouse aborde une réalité sociale souvent invisible : les violences symboliques et psychologiques subies par les employés de maison. Pourquoi avoir choisi de traiter ce thème à travers la réalité virtuelle ?
Dominic Desjardins : C’est Charlotte Bruneau qui a initié ce projet. Elle menait déjà une recherche approfondie sur ce sujet en vue d’un documentaire et m’a proposé de collaborer pour l’adapter en réalité virtuelle. Nous nous étions rencontrés au Musée canadien pour les droits de la personne, à Winnipeg, où j’animais un atelier sur l’usage du VR et de l’AR dans un contexte muséal.
Son idée m’a immédiatement intéressé : elle mettait en lumière une réalité invisible et j’ai à cœur d’explorer des problématiques sociales qui restent dans l’ombre, d’autant plus avec les nouvelles technologies. Pour moi, la réalité virtuelle porte une grande promesse : celle de créer un sentiment de présence, et donc d’empathie. Comme créateur, je me demande toujours comment aller plus loin dans cette direction, comment se mettre véritablement “dans les chaussures de l’autre”. C’est un médium qui fait appel à l’action, et donc à une forme d’expérience non pas didactique mais sensorielle, presque physique. Au lieu d’associer un sujet à une idée abstraite, on l’associe à une expérience vécue, à un moment de présence. Et je crois que c’est ce qui lui donne plus d’impact, ce qui permet de créer un lien plus fort avec le sujet.
Le regard de l’enfant et la métaphore de la maison de poupée
Vous avez choisi de raconter cette histoire à travers les yeux de Juniper, une fillette de 9 ans, et dans l’univers métaphorique d’une maison de poupée. Pourquoi cette combinaison – le regard innocent de l’enfance et la mise en scène symbolique du foyer miniaturisé – vous a-t-elle semblé la plus juste pour aborder un sujet aussi lourd ?
D. D. – Charlotte avait déjà exploré cette idée dans sa recherche. Elle s’intéressait beaucoup à la perspective des enfants dans la famille, et à la manière dont ils perçoivent les tensions quand la relation se dégrade entre les parents et la personne employée à la maison. Notre but n’était pas de traiter d’une situation propre à un pays ou à un milieu social, mais d’un phénomène universel. Adopter le regard d’un enfant nous permettait d’entrer au cœur des mécanismes humains, ceux qui nous font reproduire les comportements de nos parents ou de notre entourage sans nous en rendre compte. Ce glissement inconscient, cette manière dont la violence symbolique peut s’installer sans intention malveillante, c’est précisément ce que nous voulions explorer.
Je trouve intéressant de parler des droits humains dans un cadre intime, domestique – loin des contextes de guerre ou de crise dans lesquels ils sont évoqués habituellement. Ces abus peuvent exister dans la cellule familiale, parfois de manière banale, presque imperceptible.
Dans The Dollhouse, Juniper est une enfant qui se questionne. À travers son petit monde en papier, elle rejoue les événements comme si un thérapeute lui avait demandé de reconstruire l’histoire pour mieux la comprendre. Cette approche permet au spectateur de “jouer” lui aussi, d’abord de manière innocente, puis de réaliser qu’il participe, sans le vouloir, à l’accroissement de la souffrance de l’autre. C’était l’un de nos objectifs : imaginer des actions ludiques mais porteuses de sens, qui impliquent le spectateur et l’amènent à devenir, malgré lui, acteur de ce glissement, comme le sont parfois les témoins silencieux d’une injustice.
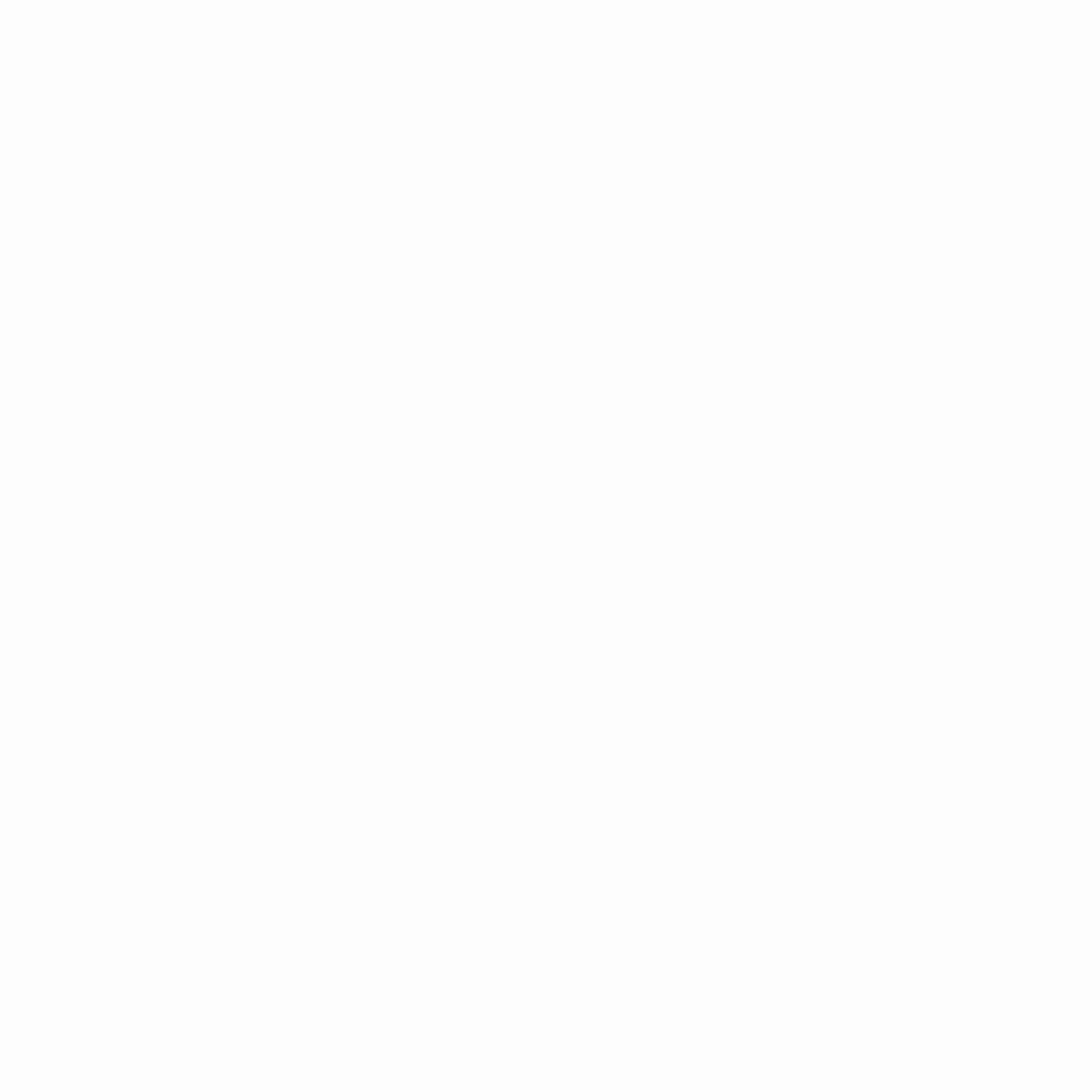
Interactivité et rôle du spectateur
Les gestes proposés au spectateur – manipuler une poupée et guider ses actions – sont à la fois simples et lourds de sens. Est-ce une manière de le rendre acteur de la violence symbolique, pour l’amener à en comprendre les mécanismes, et la façon dont celle-ci peut être intériorisée et banalisée ?
D. D. – Oui. Dans une expérience en VR, on pourrait tout à fait placer l’utilisateur à la première personne, le faire incarner celui ou celle qui vit l’histoire. Mais nous voulions tout de même garder cette idée d’un petit monde qui se déroule devant nous, d’accompagner quelqu’un dans son cheminement. Nous voulions que le spectateur soit comme un confident, un ami proche, un témoin silencieux de ce qui se joue.
Pour le rendre actif, nous avons imaginé des activités très simples, presque ludiques, qui amènent peu à peu le spectateur à participer à la situation – sans qu’il s’en rende compte d’abord. Au fur et à mesure, il devient acteur, même si ce n’est pas non plus un récit à embranchement : on ne change pas le cours de l’histoire, il n’y a pas de choix qui la modifient. C’est une forme d’implication poétique.
Ce qui nous intéressait, c’était de créer un niveau de lecture supplémentaire : comment une action anodine, réalisée dans le flux de l’histoire, peut soudain révéler une compréhension plus profonde. Par exemple, quand Juniper s’amuse à lancer des avions en papier dans la maison, sans réaliser qu’ils s’écrasent contre les murs et laissent des traces que l’employée domestique devra nettoyer, elle contribue à sa charge sans le vouloir. Nous, spectateurs, faisons la même chose : on nous donne des avions, nous les lançons sans y penser, puis on voit l’employé domestique nettoyer derrière nous. Et là, quelque chose se passe. On comprend physiquement, presque corporellement, que nos gestes, même les plus innocents, peuvent peser sur les autres. Cette prise de conscience, pour moi, c’est le cœur du projet : comprendre le glissement progressif, invisible, qui mène à l’abus et ressentir, à travers l’expérience, la culpabilité et le désir de réparation de la jeune fille.
Direction artistique et gradation de la violence
L’expérience puise dans l’esthétique du papier découpé, du théâtre d’objets et des ombres chinoises pour créer un univers à la frontière de l’enfantin et de l’inquiétant. Quelles ont été vos sources d’inspiration ? Comment cette identité visuelle vous a-t-elle permis de traduire à la fois la complexité du sujet et la gradation de la violence qui conduit à la prise de conscience ?
D. D. – Nous trouvions très évocateur de créer un monde qui naît à partir de rien, puis se désintègre peu à peu. En VR, il y a toujours ce danger : tout peut être créé, montré, dans un univers pixelisé, au risque de perdre en sensibilité. Avec Charlotte, nous pensions que se limiter dans les matériaux pouvait justement nous conduire vers une expérience plus vraie, plus tangible. Nous voulions que le spectateur ait l’impression d’être devant des éléments qui existent, presque palpables. C’est cette contrainte, je crois, qui renforce le sentiment de présence.
Nous avons donc travaillé uniquement avec des matériaux simples : du papier, de la corde, de la mousse, du carton. Nous voulions que ce monde soit fragile, à l’image de l’enfance et de la situation racontée. Quelque chose d’éphémère, qui apparaît, disparaît, se transforme. C’est de là qu’est née cette esthétique, grâce au travail de Sophie Dubé, une directrice artistique canadienne formidable, dont les dessins ont ensuite été transposés en 3D.
J’ai toujours été fasciné par les premières expériences VR comme Allumette, du studio Penrose, où le spectateur devient la caméra. Il se promène, observe, choisit son point de vue. Je trouve merveilleuse cette liberté de composer son propre regard. C’est exactement ce que je voulais retrouver : un petit monde précieux qui se déploie devant nous, dans lequel chacun peut se déplacer à son rythme, observer une expression, un geste, un détail. Le monde de papier nous permettait cela : un véritable théâtre miniature.
Limiter notre esthétique permettait également de s’éloigner du réalisme ambigu de la VR – ce moment où l’on se demande si ce qu’on voit est « bien fait » ou pas. Ici, tout est tracé, colorié, dessiné à la main. Rien de vectoriel. Et c’est cette dimension artisanale qui rend le projet, je crois, plus organique, plus vivant et qui crée ce lien de proximité avec ce qui se déroule sous nos yeux.
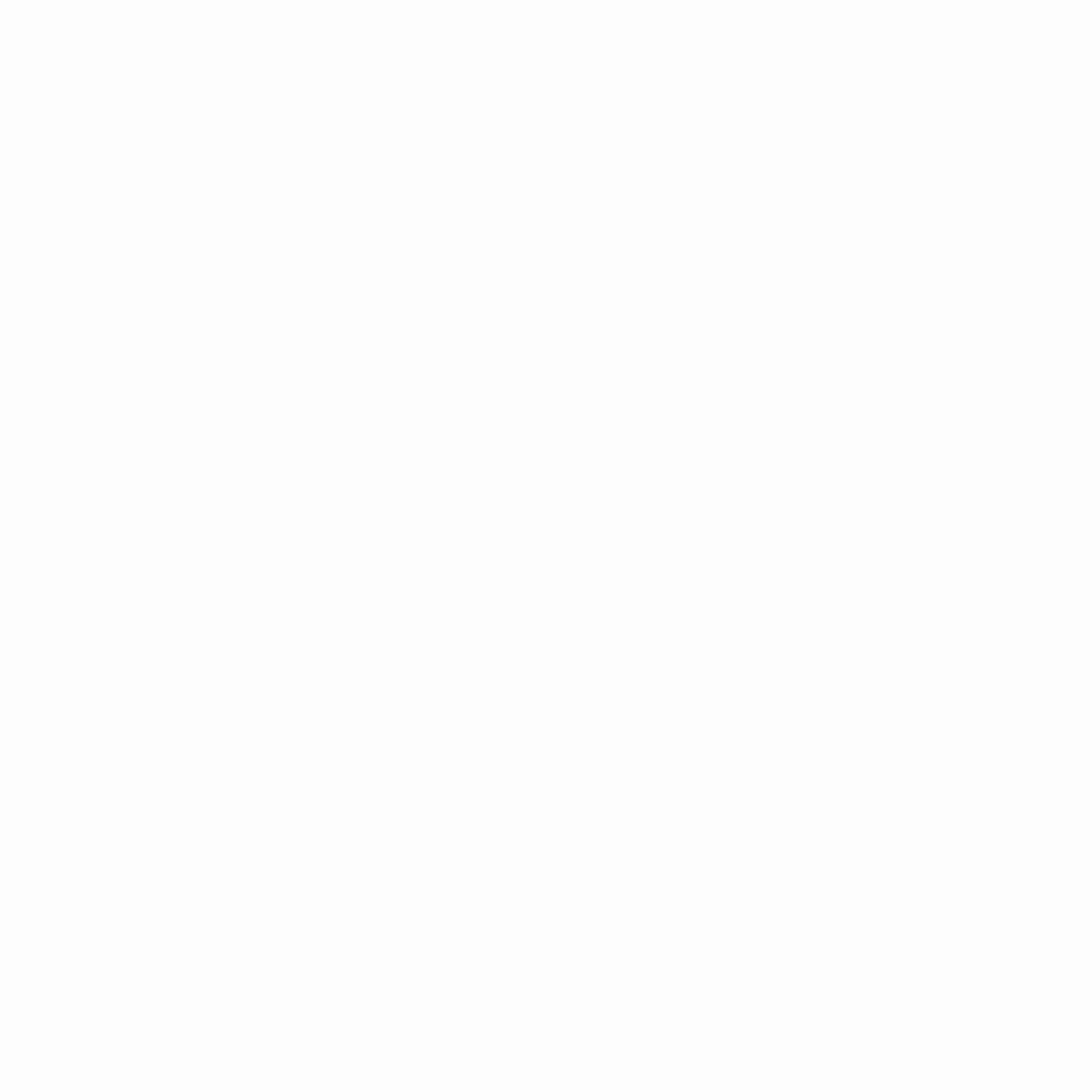
Prise de conscience et progression narrative
Juniper, comme le spectateur, progresse dans une prise de conscience graduelle, jusqu’à un point où le récit ne laisse plus d’ambiguïté sur ce qu’elle a vécu et observé. Comment avez-vous conçu ce cheminement narratif et cette “éthique de la clarté”, afin d’éviter toute équivoque sur un sujet aussi sensible ?
D. D. – Je pense que ce projet explore vraiment les zones grises : réaliser dans une situation d’abus des droits humains qu’on a soi-même contribué à cet abus malgré notre bonne volonté, nos valeurs ou notre désir de bien faire. Il n’y a pas de “méchant” désigné : la mère, le père ou n’importe quel autre protagoniste ne sont pas animés par une intention malveillante. Ce que nous voulions révéler, c’est que ces situations peuvent évoluer de manière insidieuse si nous n’y prenons pas garde.
Ce glissement progressif était essentiel à représenter, car il ne repose pas sur une seule action, mais sur une accumulation de petits comportements : déshumaniser l’autre, juger que ses droits sont moins importants que nos besoins, penser que l’on peut, pour “sa sécurité”, limiter sa liberté de circuler, de communiquer, etc. Revenir sur ses valeurs et sur ses actes nous plonge forcément dans une zone grise : ce n’est ni noir ni blanc, il n’y a pas qu’un seul coupable.
Le point de vue de l’enfant nous permet de rappeler que cette innocence et cette bonne volonté sont présentes au départ… avant que tout ne glisse. Ce que le projet veut transmettre, c’est qu’il faut rester vigilant. Et je crois que l’on peut élargir cette réflexion : les atteintes aux droits humains se produisent aujourd’hui, même à l’échelle politique, en partant de “bonnes intentions” qui dégénèrent. Ce glissement, malgré nous, malgré notre envie que tout soit beau et juste, existe bel et bien : il faut comprendre que nos actes ont des conséquences.
Fiction, engagement et VR
À travers son langage métaphorique et poétique, The Dollhouse montre que la fiction peut être un outil de compréhension et de dénonciation de réalités sociales complexes. Cet engagement est-il pour vous un impératif dans le choix de vos thématiques ? Et pensez-vous que la VR possède une capacité particulière à éveiller, sensibiliser et faire ressentir ces vérités invisibles ?
D. D. – Oui, je crois profondément que la VR nous permet d’explorer des sujets où l’on peut se rapprocher de l’humain, en générant une empathie “présentielle”, c’est-à-dire ancrée dans le vécu. Ce potentiel participatif reste encore largement à explorer. Charlotte vient du journalisme et du documentaire, j’ai moi-même produit et réalisé de nombreux documentaires. Se rapprocher de l’humain, traiter des problématiques sociales, c’est au cœur de mon travail.
Avec les nouvelles technologies, le risque est de laisser l’industrie du jeu vidéo dicter la direction. Je leur laisse volontiers le terrain du pur divertissement, je n’ai pas vocation à m’y engager. En revanche, pour que des technologies encore marginales comme la VR trouvent leur place, elles ont besoin de créateurs qui remettent l’humain au centre de l’équation. La question n’est pas : “Qu’est-ce que la technologie peut faire ?” mais plutôt : “Qu’avons-nous à raconter de notre humanité grâce à elle ?”. La technologie doit rester un outil et non une finalité. Créer uniquement pour démontrer une prouesse technique conduit à des œuvres creuses, qui ne durent pas ; d’ailleurs, le nouveau gadget finit toujours par remplacer le précédent.
Comme pour le cinéma ou toute autre forme artistique, chaque avancée demande des créateurs capables de replacer l’expérience humaine, l’empathie, au cœur du récit. Et c’est exactement ce que nous avons essayé de faire avec Charlotte.
Présenté en première mondiale à Cannes Immersive 2025, The Dollhouse poursuit depuis un parcours remarquable dans les festivals : nommé au BFI London Film Festival 2025, aux Luxembourg Film Awards 2025, à United XR Europe 2025, ou encore au Geneva International Film Festival (GIFF) 2025, le projet a également été distingué en remportant le KFF XR Spark Award 2025 et le grand prix à Sandbox à Beijing. Une reconnaissance qui confirme la puissance d’un récit sensible, au plus près des zones grises, et la capacité de la VR à ouvrir de nouveaux espaces d’empathie et de prise de conscience.


